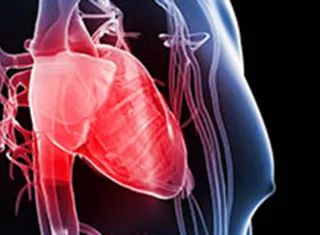Par Nestlé Nutri Pro ®
Les maladies cardiovasculaires sont aujourd’hui la première cause de mortalité dans le monde, et représentent un véritable problème de santé publique. Leur développement dépend de plusieurs facteurs, certains modifiables et d’autres non, parmi lesquels l’alimentation tient une place importante.
Les maladies cardiovasculaires : définition
Les maladies cardiovasculaires (MCV) constituent un ensemble de troubles touchant le cœur et les vaisseaux sanguins avoisinants et pouvant prendre de multiples formes. 1
Les cardiopathies coronariennes ou ischémiques 1,2
Les cardiopathies coronariennes - ou ischémiques - sont des maladies cardiovasculaires touchant les vaisseaux alimentant le muscle cardiaque. Elles sont consécutives à un arrêt ou à une réduction de l’irrigation sanguine du myocarde, en lien généralement avec l’athérosclérose des artères coronaires. 1,2
On distingue différents syndromes :
- syndromes coronaires aigus
- infarctus du myocarde
- angine de poitrine
- atteinte ischémique chronique avec insuffisance cardiaque
- troubles du rythme cardiaque, voire mort subite.
Les maladies cérébro-vasculaires
Ces maladies cardiovasculaires touchent les vaisseaux sanguins alimentant le cerveau. 1
On distingue deux grands types d’accident vasculaire cérébral (AVC) 2 :
- les AVC hémorragiques : dus à une rupture d’un vaisseau sanguin
- les AVC ischémiques (infarctus cérébraux) : consécutifs à l’obstruction d’une artère cérébrale
Le symptôme le plus courant d’un AVC est une sensation de faiblesse soudaine au niveau de la face, du bras ou de la jambe, le plus souvent sur un seul côté du corps. On peut également constater l’apparition brutale de ces symptômes 1 :
- engourdissement de la face, du bras ou des jambes
- confusion
- difficultés à parler ou à comprendre un discours
- difficultés visuelles touchant un œil ou les deux
- difficultés à marcher
- étourdissements
- perte d’équilibre ou de coordination
- céphalées sévères sans cause connue
- syncope ou perte de conscience.
Les accidents ischémiques transitoires (AIT) sont une autre forme de maladie cérébro-vasculaire. Ce sont des accidents vasculaires d’origine ischémique caractérisés par la régression précoce (typiquement en moins d’une heure) et complète des déficits neurologiques et l’absence d’image d’infarctus cérébral. 2
Les artériopathies périphériques
Ces maladies cardiovasculaires touchent les vaisseaux sanguins alimentant les bras et les jambes. 1
La plus connue de ces affections est l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI). Elle est caractérisée par un rétrécissement du calibre des artères qui irriguent les membres inférieurs, se traduisant par une chute de l’Index de Pression Systolique (IPS : rapport pression artérielle systolique à la cheville sur pression systolique humérale, mesurées à l’aide d’une sonde Doppler). 3
Cette maladie se présente sous deux formes :
- l’ischémie d’effort, avec ou sans signes cliniques liés à l’ischémie, qui est chronique. Par rapport au risque local, le risque cardio-vasculaire domine largement le pronostic et la prise en charge
- l’ischémie permanente, qui peut être chronique ou aiguë : le risque local est pour un temps prépondérant, mais la prise en charge du risque cardio-vasculaire reste essentielle.
Les cardiopathies rhumatismales 1
Ces maladies touchent le muscle et les valvules cardiaques et résultent de l’inflammation et des lésions cicatricielles laissées par un rhumatisme articulaire aigu. Cette maladie, causée par une bactérie streptocoque débute généralement par une angine ou une amygdalite chez l’enfant. Les symptômes sont les suivants :
- essoufflement, fatigue, arythmie cardiaque, douleur thoracique et syncope pour une cardiopathie rhumatismale
- fièvre, douleur et gonflement au niveau des articulations, nausées, crampes stomacales et vomissements pour un rhumatisme articulaire aigu.
- les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires
- les thromboses veineuses profondes sont définies par l’obstruction des veines des jambes par un caillot sanguin. Ce caillot est susceptible de se libérer et de migrer vers le cœur ou les poumons, on parle alors d’embolie pulmonaire. 1
Le diagnostic clinique est souvent difficile car les signes cliniques ne sont pas spécifiques. 4
Le collapsus cardiovasculaire est la forme clinique la plus grave de l’embolie pulmonaire. Il est dû aux amputations vasculaires les plus importantes responsables d’un obstacle aigu à l’éjection du ventricule droit et/ou à une grande hypoxie. 4
Les complications précoces de l’embolie pulmonaire sont les récidives thromboemboliques, la survenue d’un choc cardiogénique, et les exceptionnelles embolies paradoxales responsables d’une embolie artérielle, le plus souvent cérébrale. L’infarctus pulmonaire correspond à l’arrêt de toute perfusion artérielle pulmonaire ou bronchique. 4
L’insuffisance cardiaque
Elle est définie comme l’incapacité du cœur à assumer, dans des conditions normales, le débit sanguin nécessaire aux besoins métaboliques et fonctionnels des différents organes. C’est un syndrome hétérogène qui regroupe des étiologies, des mécanismes physiopathologiques et des expressions cliniques diversifiées. 2
Elle peut être due à une anomalie de la fonction systolique, conduisant à un défaut d’éjection du sang, ou à une anomalie de la fonction diastolique conduisant à un défaut de remplissage ventriculaire. 4
Elle évolue en dents de scie avec des phases de décompressions aiguës qui représentent une cause fréquente d’hospitalisations des personnes âgées. Enfin, l’insuffisance cardiaque peut être source de complication pour différentes pathologies cardiovasculaires telles que les cardiopathies ischémiques, cardiopathies valvulaires, cardiomyopathies, fibrillation auriculaire, hypertension artérielle... 2
L’hypertension artérielle 5
L’hypertension artérielle représente l’un des principaux facteurs de risque vasculaire. Elle est définie par une pression artérielle systolique (PAS) ≥ 140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) ≥ 90 mmHg, mesurées au cabinet médical (135/85 par automesure ou 130/80 en MAPA sur 24h), et confirmées (au minimum par 2 mesures par consultation, au cours de 3 consultations successives, sur une période de 3 à 6 mois).
La relation entre le niveau de PAS et de PAD et le risque de survenue d’un d’AVC ou d’un événement coronaire est bien établie. L’HTA serait à l’origine de 20 % des décès cardiovasculaires chez l’homme et de 24 % chez la femme (2ème cause de mortalité après le tabac).
Épidémiologie : les MCV, première cause de mortalité dans le monde
Les maladies cardiovasculaires dans le monde
Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité en Occident. On estime à 17,3 millions le nombre de décès annuels dans le monde, imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 30 % de la mortalité mondiale totale.1 En Europe, elles sont à l’origine d’environ 40 % des décès, soit l’équivalent de 2 millions de morts chaque année. 6
Parmi les 17,3 millions de décès annuels, on estime que 7,3 millions sont dus à une cardiopathie coronarienne, et 6,2 millions à un AVC. 1
L’athérosclérose et ses conséquences ou complications sont la cause de plus de 90 % des syndromes coronariens aigus et de plus de 50 % des AVC.
La mort subite, définie par un décès dans les 3 à 24 heures suivant l’évènement initial qui est le plus souvent sans prodromes, représente 50 à 60 % de la mortalité cardiovasculaire dans les pays développés. 80 % des patients ayant eu une mort subite sont des patients coronariens. A côté de la mortalité prématurée, la morbidité cardiovasculaire est un problème majeur de santé publique. 7
D’ici 2030, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) estime que près de 23,6 millions de personnes mourront d’une maladie cardiovasculaire (cardiopathie ou AVC principalement). 1
Plus de 80 % des décès par maladie cardiovasculaire surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Les habitants de ces pays sont les plus exposés aux facteurs de risque cardiovasculaires et font moins l’objet d’efforts de prévention que les habitants des pays à revenu élevé. Ils ont également moins accès à des services de santé efficaces et équitables répondant à leurs besoins et de ce fait meurent plus jeunes de maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires constituent ainsi un réel problème de développement pour les pays à faible revenu ou intermédiaire. Toujours selon l'OMS au niveau macroéconomique, on estime que les cardiopathies, les AVC et le diabète réduiraient le PIB des pays à revenu faible et intermédiaire, de 1 à 5 % en raison de cette mortalité prématurée. 1
Les maladies cardiovasculaires en France 4
La France est un cas particulier dans le monde occidental puisque les maladies cardiovasculaires y représentent la deuxième cause de mortalité derrière le cancer.
On constate également en France une forte disparité régionale :
- Beaucoup moins d’accidents coronaires dans le sud que le nord
- Régions les plus touchées : Bretagne, Normandie, Nord/Picardie, Alsace et Lorraine
- Régions les moins touchées : Midi, Pyrénées/Aquitaine, Centre-Ouest
- En Île de France, le nombre d’accidents cardiovasculaires est en-dessous de celui du Nord et on retrouve un taux moindre de mortalité par rapport au reste du territoire national.
Ces données confirment le rôle de la qualité de la prise en charge et du niveau socio-économique.
Facteurs de risque des maladies cardiovasculaires
D’une façon générale, le risque de développer une maladie cardiovasculaire donnée peut varier en fonction de la présence ou de l’absence de caractéristiques individuelles socio-économiques ou environnementales. 4
Facteurs de risque non modifiables
- l’âge : l’incidence des MCV augmente de façon quasi exponentielle avec l’âge
- le sexe : le sexe masculin prédispose aux MCV, les femmes seraient quant à elles protégées jusqu’à la ménopause
- les antécédents familiaux de MCV : le risque augmente lorsque des antécédents de MCV ont été développés précocement chez au moins un parent du 1er degré, avant 55 ans chez un homme et 65 ans chez une femme.
Facteurs de risque modifiables
- l'hypercholestérolémie : essentiellement d’origine génétique et pour une part d’origine alimentaire
- l’HTA (hypertension artérielle): premier facteur de risque des AVC avec ou sans athérosclérose
- le diabète de type II : multiplie par 2 à 3 chez l’homme et par 3 à 5 chez la femme, le risque relatif de maladie coronarienne et d’AVC ischémique, et de 4 à 6 celui d’AOMI
- l’obésité : facteur de risque indirect des MCV passant par le développement d’une insulino-résistance et d’une HTA
- le tabagisme : facteur de risque de MCV bien caractérisé, corrélé de façon linéaire à la consommation de tabac et à la durée de l’intoxication
- la sédentarité et le stress : aggravent les facteurs de risque précédents
- l’alimentation : une alimentation riche en graisses saturées et hypercalorique est un facteur de risque bien établi dans le développement des MCV
À côté des facteurs de risque, sont décrits des marqueurs de risque, eux-mêmes beaucoup plus nombreux, pour lesquels la relation de causalité n’est pas forcément reconnue. 7
Facteurs protecteurs contre les maladies cardiovasculaires
Des facteurs protecteurs ont également été mis en évidence. Il s’agit notamment : d’une concentration plasmatique élevée en cholestérol-HDL, la consommation de fruits et légumes, ou encore la pratique d’une activité physique. 7 Retrouvez notre article sur les recommandations nutritionnelles et conseils sur les comportements alimentaires afin de préserver la santé du cœur.
Pour en savoir plus
- Nestlé Nutrition Institute, et la rubrique « cardiovascular diseases »
- Nestlé Health Science France
Sources
1. OMS. Maladies cardio-vasculaires. Aide-mémoire. Septembre 2011. Disponible sur le site http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/fr/index.html
2. InVS. Dossiers thématiques. Maladies chroniques et traumatismes. Maladies cardiovasculaires. Dernière mise à jour le 21/04/2011.
3. HAS. Guide ALD. Artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Mars 2007.
4. Baudin B, Cohen A. Données épidémiologiques des maladies cardiovasculaires et prise en charge des accidents cardiovasculaires. Revue francophone des laboratoires 2009;409:27-39.
5. HAS. Note de cadrage. Evaluation des médicaments antihypertenseurs et place dans la stratégie thérapeutique. 2010.
6. Commission européenne. Santé-UE. Maladies cardiovasculaires. Disponible sur le site : http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/cardiovascular_diseases/index_fr.htm
7. Anses. Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras. Rapport d’expertise collective. Edition scientifique. Mai 2011.
Date de mise à jour : 09/06/2023